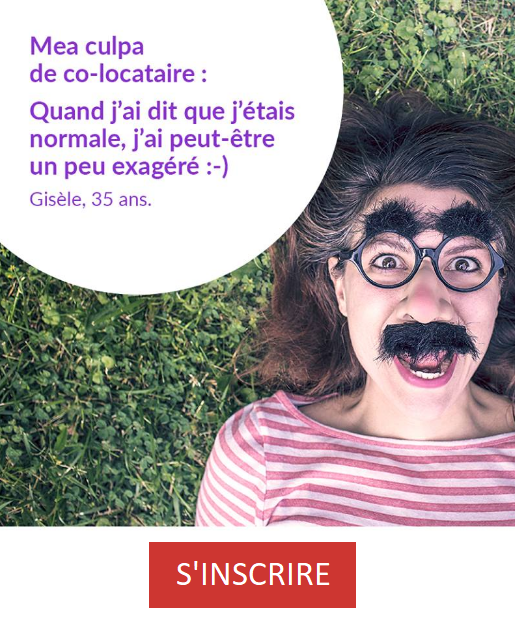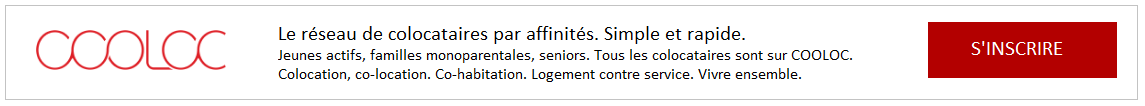Habitat participatif, une originalité qui pourrait bien devenir la norme !

Et si l’habitat participatif devenait une alternative sérieuse au mode de logement traditionnel ? Demain, tous sous le même toit, c’est possible ?
En tout cas, en Europe, les exemples ne manquent pas. En Suisse, les logements collaboratifs représentent 5 % du parc immobilier ; en Allemagne, 12,2 millions de logements et 5 millions d’habitants.
Il existe aujourd’hui plus de mille habitats participatifs en France, et le nombre de projets se chiffre à plusieurs centaines, en dépit de toutes les difficultés de mise en place. La preuve que ce mode de vie attire. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Le marché de l’habitat participatif en france
Dans l’hexagone, les projets d’habitat participatifs représentent :
– + 600 projets (5 000 à 7 000 logements)
– 170 projets aboutis (1 400 logements)
– 280 en phase d’études ou de construction
– Une croissance de 13% ces dernières années
Qu’est-ce que l’habitat participatif ?
Un logement partagé c’est d’abord un projet porté par un groupe de personnes. Ensemble, ils décident de concevoir et créer un habitat en commun qui s’adapte exactement à leurs besoins.
La plupart du temps, ils partent de zéro. Difficile, en effet, de trouver un ou des bâtiments existants qui s’adaptent exactement aux exigences de chacun ! Mais il arrive parfois de bonnes surprises. Par exemple, en Belgique où un corps de ferme a été transformé en cette forme de co-résidence.
A l’origine des habitats participatifs, il y a d’abord un groupe de personnes : des familles ou des célibataires, des parents solos ou des seniors, des urbains qui veulent rester en ville, rêvent de vie à la campagne ou veulent plus d’espace… Les profils sont aussi divers que variés ! Mais ils ont un point commun : la volonté de prendre en main leur habitat. Refusant l’idée de s’enfermer dans des appartements ou des maisons individuelles, ils se rassemblent en groupe pour concevoir, créer et gérer leur logement.
Ce dernier allie des espaces privatifs pour chaque famille : un appartement avec chambres, salle de bains, cuisine, pièce à vivre, plus ou moins grandes, voire plus petits que la moyenne… Au profit de larges espaces communs, afin de développer une forme de communauté d’habitants. L’objectif est de créer le logement qui corresponde aux aspirations de chacun, tout en maintenant les valeurs du partage et du vivre ensemble.
Les raisons du succès
1. La hausse des prix des loyers
Au deuxième trimestre 2023, le marché enregistre une hausse de 6,13 % sur un an (INSEE). Une tendance qui s’intensifie depuis 2018.
2. Faciliter les relations humaines
Les habitants qui décident de vivre ensemble acceptent notamment de consacrer une partie de leur temps et de leur énergie au service de la communauté.
C’est ainsi que fonctionne la maison des Babayagas de Montreuil. Les habitantes, puisqu’il s’agit de femmes retraitées, s’engagent à dédier une partie de leur temps libre à la vie de la maison et du quartier, en fonction de leurs compétences et de leurs affinités.
D’une manière générale, quelle que soit la forme de l’habitat, l’aspect participatif est bien présent, ne serait-ce que pour prendre les décisions concernant le logement ou les parties communes.
Et cela se fait d’autant plus naturellement que ces logements ont prévu et organisé des espaces communs : jardin, local à vélo, salle commune, salle de jeux pour les enfants, voire cave à vins commune… soit autant d’occasions de se retrouver entre voisins.
3. Des facilités administratives
Côté législation, la loi ALUR de 2014 apporte un encadrement juridique. Les porteurs d’un projet de d’habitat participatif peuvent décider de s’unir en une coopérative d’habitants ou d’une société d’attribution et d’autopromotion. Ils doivent acquérir des parts de ces sociétés d’habitat participatif.
Les associés participent à la conception et aux décisions relatives à l’acquisition, à la construction de l’immeuble puis à sa gestion. Elles sont responsables de l’achèvement de l’immeuble construit. Elles garantissent aux associés la jouissance des logements.
La loi ALUR permet notamment d’admettre comme associés des personnes morales et notamment des organismes de logement social. Elle limite la responsabilité des associés à leur apport dans le capital.
Les locataires non associés, eux, doivent signer une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble. Celle-ci est annexée à leur contrat de bail, notamment les règles concernant les lieux de vie collective.
Pour éviter toute spéculation, le prix de cession des parts sociales est limité à leur montant nominal majoré sur l’indice de référence des loyers (IRL). Les sorties de la société sont encadrées afin de sécuriser l’équilibre financier de la société.
Enfin les associés coopérateurs paient une redevance, pour rembourser l’emprunt contracté par la société pour la construction de l’immeuble. Lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, certains associés peuvent apporter leurs compétences. Ils souscrivent alors des parts sociales en industrie. Elles correspondent à un apport travail lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti. Ces parts font partie de la formation du capital social.
Selon Habitat Participatif France, l’habitat participatif a commencé à prendre pied en France au début des années 2000. L’essor véritable date de 2014. En 2021, on recensait 2 900 habitats partagés recensés. Le nombre réel serait supérieur de 30% estime Habitat Participatif France. Chaque année, 300 logements sont livrés, tandis qu’une centaine de projets démarre. Le nombre de projets augmente sans cesse. Selon l’association, près de 15 000 logements pourraient voir le jour d’ici 2030. En moyenne, 2 400 nouveaux logements sont livrés chaque année.
4. Une loi favorable à l’habitat à plusieurs
Cela ne doit pas vous rebuter. Le logement dit groupé a bonne réputation. Même le législateur cherche à le favoriser. Depuis 2014, la loi ALUR permet la mise en place de :
sociétés d’autopromotion dont l’objectif est de construire ou acheter un bien immobilier selon des aspirations communes (environnementales, sociales, économiques) pour le partager entre différents propriétaires ;
coopératives d’habitants dont l’objectif est de gérer collectivement l’immeuble ou le terrain occupé conjointement et d’accorder la jouissance des logements et des espaces communs, de la construction, l’acquisition, la rénovation, la gestion et de l’entretien.
5. La forte tendance du développement durable
Si créer un habitat de ce type peut relever du parcours du combattant, cela en vaut pourtant la peine vu les avantages que vous en tirerez :
un logement qui correspond exactement à vos besoins et à votre style de vie ;
respectueux de l’environnement en utilisant des matériaux de construction locaux et des énergies renouvelables ;
et aussi incroyable que cela paraisse, c’est un modèle de logement économique. La mutualisation du coût d’achat et de construction vous permet d’économiser en moyenne 30% par rapport au marché. Vous évitez la marge du promoteur. Avec les parties communes (jardin, buanderie, garage, ou encore salle commune ou salle de jeux…) vous gagnez en espace tout en réduisant le coût de votre logement. En décidant ensemble de la gestion de la cohabitation, vous vous passez d’un syndic de copropriété.
Et bien sûr, vous disposez de votre espace mais restez ouvert sur la vie en communauté et sur les autres.
Et cela reste une expérience humaine unique, comme le raconte une jeune femme vivant dans une résidence commune à Lille : “j’ai l’impression de me saisir d’un bout de la ville, d’y mettre ma pierre.» Une belle façon de réinventer son logement !
Une alternative au logement traditionnel marquée par de nombreuses défis
S’accorder sur un projet commun
Des atouts environnementaux et sociaux, un encadrement législatif, des économies non négligeables aussi bien comme investissement que dans la gestion du bien. Et pourtant, il n’y a encore que peu de projets en cours. Pourquoi ?
La complexité du projet peut en rebuter certains. D’une part, vous devrez trouver d’autres personnes qui non seulement veulent se lancer dans l’habitat participatif, mais ont des critères compatibles avec les vôtres. Rien que cela peut représenter un défi. Les besoins ne seront pas les mêmes si vous cherchez à lancer une activité artisanale ou agricole, ou si vous souhaitez rester en ville. N’oubliez pas que l’habitat participatif est un véritable projet de vie. Le collectif ToitMoiNous à Villeneuve d’Ascq a dû apprendre à travailler ensemble pour concevoir l’architecture du futur habitat et les règles de vie inhérentes.
Vous devrez ensuite définir le lieu d’implantation de l’habitat, en fonction des critères qui sont fondamentaux pour l’ensemble du groupe.
Cela vous donne déjà un premier aperçu de l’aventure que représente l’habitation participative : savoir ce que l’on recherche à travers ce projet, et discuter, échanger beaucoup. Ne croyez pas que les désaccords signent forcément la fin du projet. Mais parler, et faire parler l’intelligence collective permet de résoudre de nombreux problèmes et, encore mieux, de réfléchir sur des points que vous n’auriez pas abordés seul.
Une fois le projet défini, n’hésitez pas à vous organiser en collectif, voire en société d’habitat participatif, afin que chacun devienne associé et ait voix au chapitre. N’hésitez pas non plus à solliciter des experts qui peuvent vous accompagner au cours de cette aventure.
Trouver le graal … c’est-à-dire le lieu
Selon les régions, les villes, le lieu sera plus ou moins difficile à trouver. Si vous cherchez en Île-de-France par exemple, les terrains à bâtir sont devenus une denrée rare et chère. Mais l’est de la région offre encore des possibilités. N’hésitez pas à répartir la recherche entre les membres du groupe afin de trouver le lieu qui vous conviendra à tous.
Où chercher ? Les possibilités ne manquent pas :
Sur les plateformes dédiées : par exemple, Habitat Participatif France recense tous les projets, notamment des groupes qui ne sont pas encore complets
Dans les agences immobilières : renseignez-vous auprès des communes qui vous intéressent sur les projets d’aménagement en cours, les terrains et biens en voie de mutation à court ou moyen terme
Faites de la prospection de terrain : interrogez le voisinage afin de mieux connaître la situation.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. En immobilier, le bouche-à-oreille fonctionne très bien !
Prendre en compte les spécificités du bien
Une fois le terrain trouvé, l’étude du PLU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune permet d’évaluer sa capacité foncière. Celle-ci permet de définir, selon le prix du terrain et le nombre de mètre carrés constructibles, la viabilité du projet et son équilibre économique.
Qu’en est-il si le projet s’oriente vers la rénovation d’un immeuble ou d’un bâtiment existant ? Partant de l’existant, les travaux devraient être plus rapides. En effet, pour une construction et un raccord aux réseaux, il faut parfois compter jusqu’à 4 ou 5 ans d’attente.
Dans le cadre d’une rénovation, vous ne partez pas de zéro. Le bâtiment est relié aux réseaux d’eau, d’électricité… Les travaux de réhabilitation et d’aménagement peuvent cependant être difficiles et coûteux. Il faut tenir compte de l’état du bâtiment, de la surface habitable potentielle – est-elle suffisante ? – des spécificités du bâtiment – est-il soumis à des règles patrimoniales ? Des règles d’urbanisme particulières s’appliquent-elles ?
Si vous trouvez un bien prometteur, n’attendez pas. Faites déjà une première visite à plusieurs pour savoir si cela correspond à vos critères. N’hésitez pas ensuite à organiser une deuxième visite avec l’ensemble des participants et un expert, et toutes les compétences disponibles pour éviter toute mauvaise surprise et certifier la faisabilité du projet.
Si le lieu convient à tous, que toutes les études de faisabilité ont été réalisées, c’est alors le moment de négocier et d’acheter. La création d’une société d’habitat participatif prend alors tout son sens. Elle se chargera, au nom des associés, de négocier et réaliser l’acquisition.
Bien sûr, tout semble simple sur le papier, mais comme pour n’importe quelle opération immobilière, il y a souvent des imprévus, des négociations, des expertises en plus à réaliser. Enfin une fois la vente conclue, vous rentrez dans le vif du sujet.
Maintenir la cohésion du groupe dans la durée
Un projet d’habitat coopératif vit grâce au groupe et aux membres qui le composent. C’est peut-être le plus grand défi à relever, mais aussi le plus passionnant : maintenir la cohésion du groupe, pendant la phase des travaux et surtout après !
Vous devrez rapidement vous accorder sur la gestion de l’habitat participatif, établir les règles de vie dans les espaces communs et sur tout ce qui fait la vie d’une communauté. Ainsi, si les espaces communs comprennent une chambre d’amis ou une salle commune, quels sont les usages ? Comment peuvent-elles être utilisées ? Comment exploiter le jardin s’il y en a un ? Quel temps chacun doit-il dédier à la vie de l’habitat, à son entretien ? Selon quelles règles ?
Et comment parvenir à trouver des processus viables pour répondre à toutes les questions qui se posent ?
Un mode de fonctionnement fondé sur la solidarité
La réalisatrice Josyane Zardoya en a fait le sujet de son documentaire « Rue de l’Utopie ». Dans cet habitat participatif de la région de Toulouse, la communauté fonctionne, notamment en utilisant la communication non violente, remarque-t-elle.
« Assez classiquement, il y a un président de séance et quelqu’un qui prend des notes. Mais surtout ils font tourner la parole. Ils insistent beaucoup là-dessus : chacun doit s’exprimer (…) Celui qui n’est pas d’accord doit expliquer pourquoi et ce qu’il aurait voulu. Au bout d’une ou deux réunions, les positions des uns et des autres ont évolué. C’est très efficace. Parfois, selon les sujets, ils décident simplement de laisser la question de côté pour en reparler plus tard. Lorsque le sujet est vraiment épineux, ils font appel à un médiateur extérieur. »
Et sur la prise de décision collective
La plupart du temps, avant même de s’installer ensemble, les associés ont déjà mis en place des règles de gouvernance partagée. « C’est un processus très long qui peut durer de 4 à 15 ans. Avant même la construction, il n’est pas rare de passer 5 à 6 ans en réunion. Avant que cet habitat partagé ne voit le jour, il y a eu 4 ans de réunions… Tout ce temps passé à discuter et à chercher, cela permet de se rencontrer et de bien se connaître avant même d’acheter et de construire. On discute de la conception du projet, de la salle commune, de la taille de la buanderie, du jardin… Et comme dans une colocation, il faut instaurer un minimum de règles sur lesquelles on s’entend. Il faut être à l’écoute, partir sur les mêmes bases, avoir une charte de départ que tout le monde signe. »
Certains habitats participatifs ont un fonctionnement éprouvé. Dans la maison des Babayagas de Montreuil, où vivent des femmes retraitées à faibles revenus, chaque résidente s’engage à donner 10 h hebdomadaires au service de la collectivité. Ce mode de fonctionnement leur permet d’organiser des événements et des activités de quartier, et d’éviter de vivre coupées de la société.
L’habitat participatif ou réinventer l’art de vivre ensemble
D’une manière générale, tous les habitats participatifs qui voient le jour et qui perdurent – et il y en a beaucoup – ont demandé du temps, de l’implication, des efforts et de la résilience à ceux qui se sont lancés dans cette passionnante aventure. Mais le résultat en vaut la peine : c’est le fruit de la solidarité et de la confiance que se témoignent les participants, ainsi que de l’intelligence collective. Puisqu’il est bien connu qu’à plusieurs, on réfléchit mieux et l’on peut trouver des solutions plus innovantes. Mais cela suppose « la capacité à débattre, à s’asseoir autour d’une table, conscients de la richesse que représente la diversité d’opinions, de cultures et d’âge » rappelle la philosophe Marie Robert. Un petit effort pour un grand enjeu, insiste-t-elle : « l’avenir de notre société dépend du temps que nous passerons ensemble à nous connaître pour peut-être un jour croire que le collectif peut redevenir intelligent ».
Développer l’habitat participatif, oui mais avec quelles solutions ?
Fred Colantonio, consultant spécialiste de l’accompagnement des entreprises dans l’innovation et la transformation, estime que l’habitat collaboratif fait bouger les lignes. « Comment des gens vont consentir à se reloger dans un espace plus petit, partager des lieux de vie et de réduire leur propriété ? L’habitat participatif, c’est génial comme idée, de même que la colocation, la communauté… Mais il y a peu de gens qui a priori vont oser se lancer vraiment. »
C’est la raison pour laquelle on peut envisager l’habitat participatif comme une forme d’innovation. « L’important dans l’innovation, c’est moins l’idée que la manière dont on la teste et dont on va aider la société à s’en emparer. » Fred Colantonio le remarque : de nombreuses innovations, du four à micro-ondes au smartphone, ne représentaient pas une nécessité vitale. Et pourtant, aujourd’hui il est difficile de s’en passer : « on nous a appâté sur une appétence comportementale. Je pourrais faire sans mais j’y trouve un intérêt. »
Il en va de même pour l’habitat participatif. Face aux innovations, il y a dans la société, un petit pourcentage de personnes qui se lancent dans le projet dès le départ et semblent transgresser les habitudes.
A l’autre bout, il y aura toujours environs 15% des gens que vous ne réussirez jamais à convaincre et qui resteront fermement ancrés sur leurs positions. C’est la population située entre ces deux extrêmes qu’il faut convaincre, explique Fred Colantonio.
Pour cela, l’habitat collaboratif doit combattre les suppositions, pour éviter de crisper les relations. Il faut être très factuel, trouver les intersections qui permettent aux gens de s’emparer de l’idée. Par exemple en essaimant des idées du type vous avez été scout ? Vous savez, c’était déjà de l’habitat partagé. Il faut créer de l’inclusion pour que les gens s’emparent du projet et se sentent concernés.